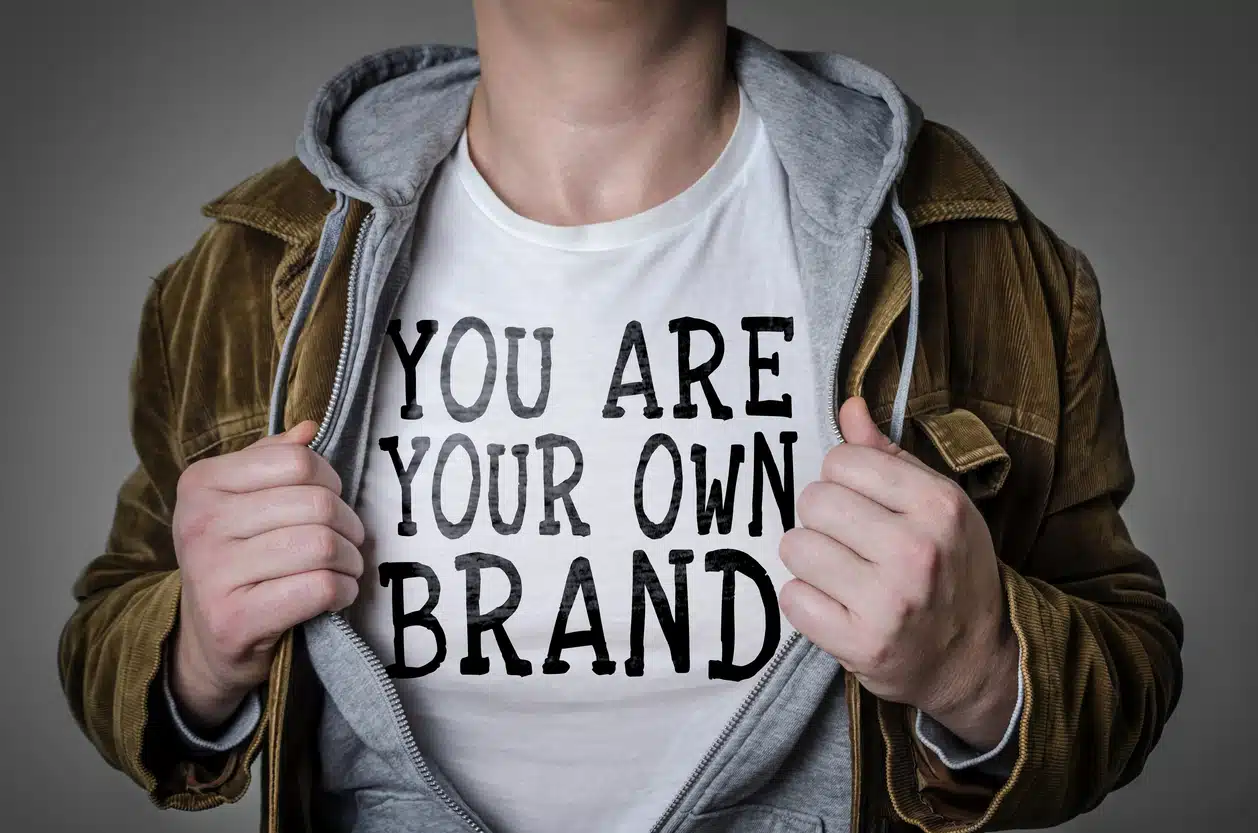Un chiffre. Une ligne de code. L’article 750-1 du Code de procédure civile bouleverse, sans tambour ni trompette, la routine contentieuse des entreprises françaises. Fini le temps où saisir le juge s’imposait comme le premier réflexe. Désormais, pour de nombreux litiges, ceux dont l’enjeu reste sous la barre des 5 000 euros ou qui relèvent des sempiternelles disputes de voisinage, il faut impérativement essayer de régler le différend à l’amiable, avant même de songer à la salle d’audience.
Ignorer cette étape revient à s’exposer à une sanction immédiate : la demande risque tout bonnement d’être rejetée d’office, sauf exceptions strictement prévues. Conséquence directe, les entreprises n’ont d’autre choix que d’adapter leurs procédures internes sous peine de voir leurs recours s’enliser ou, pire, disparaître dans les méandres du greffe.
Article 750-1 du CPC : comprendre le cadre légal du règlement amiable
L’article 750-1 CPC modifie la manière dont les entreprises abordent les contentieux. Avant d’envisager le tribunal judiciaire, une tentative sérieuse de règlement amiable s’impose dès qu’un litige civil entre dans le champ du texte. L’objectif ? Désengorger les tribunaux, pousser les parties à dialoguer et installer une nouvelle culture de la résolution des conflits.
Dans les faits, la règle s’applique dès que l’enjeu financier ne dépasse pas 5 000 euros ou en cas de querelle de voisinage, sauf si la loi prévoit explicitement une dérogation. La palette des solutions amiables s’étend de la conciliation à la médiation, sans oublier la procédure participative. Autrement dit, l’accord devient la norme, le recours au juge l’exception, du moins, en théorie.
La réforme initiée par le décret du 11 décembre 2019 a renforcé ce dispositif, s’inscrivant dans la dynamique lancée par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. L’idée est simple : multiplier les solutions amiables pour désengorger les tribunaux et accélérer le traitement des contentieux.
Ne pas respecter ce passage obligé n’entraîne pas qu’un simple rappel à l’ordre. Le juge peut déclarer la demande irrecevable, à moins qu’une exception légale, un motif légitime ou le refus de l’autre partie de participer à la tentative de règlement amiable ne soit constaté. Cette étape précontentieuse, encadrée par les articles du code de procédure civile, oblige les entreprises à repenser leur stratégie, à anticiper et à revoir leurs processus internes.
Pourquoi cette obligation change la gestion des litiges en entreprise ?
La tentative de règlement amiable ne relève plus du choix mais d’une étape imposée pour la majorité des litiges commerciaux. Cette évolution, dictée par l’article 750-1 du CPC, bouleverse la gestion du risque judiciaire en entreprise. Avant de saisir le juge, dirigeants et juristes doivent désormais intégrer cette phase à leur stratégie : chaque dossier devient l’occasion de tester l’efficacité d’une solution négociée.
La relation avec les avocats change elle aussi de nature. Le rôle de conseil va au-delà du contentieux : il s’agit désormais d’anticiper, de cadrer le dialogue, de conserver la trace de chaque tentative, qu’il s’agisse d’une mise en demeure, d’un mail ou d’un procès-verbal de réunion. Ce formalisme, loin d’être accessoire, sécurise le parcours si la conciliation échoue.
Pour les directions juridiques, la réforme introduit une nouvelle étape, parfois perçue comme contraignante, mais qui peut aussi révéler de vraies opportunités. Préserver la relation commerciale, limiter les coûts ou éviter une montée en tension : voici des bénéfices concrets, bien plus qu’un simple affichage légal. La conciliation s’impose dorénavant comme un axe structurant de la stratégie contentieuse, sous l’influence directe du code de procédure civile.
Plusieurs changements majeurs s’imposent aux entreprises :
- Mettre en place systématiquement une tentative de règlement amiable avant tout recours au juge
- Recourir plus fréquemment aux modes alternatifs de résolution des litiges
- Adapter les processus internes et former les équipes à cette nouvelle réalité
La réforme irrigue toutes les strates de l’organisation. La frontière entre le traitement opérationnel d’un incident et la gestion du contentieux devient poreuse : chaque différend peut désormais ouvrir un cycle de conciliation ou de médiation avant tout recours à la justice.
Les alternatives amiables à la saisine du juge : panorama des options pour les entreprises
Face à une judiciarisation croissante, les modes alternatifs de règlement des différends prennent une place de plus en plus visible dans la gestion des litiges d’entreprise. L’article 750-1 du CPC encourage à explorer, en amont, l’ensemble des solutions amiables disponibles. Trois voies principales se distinguent, chacune avec ses propres atouts :
La conciliation : rapidité et pragmatisme
Solliciter une conciliation, c’est faire intervenir un tiers (commissaire de justice ou conciliateur désigné par le tribunal judiciaire) pour rapprocher les positions. Outil flexible et discret, il favorise des accords personnalisés et préserve la confidentialité du différend. Cette approche convient particulièrement bien lorsque la relation d’affaires doit perdurer malgré le litige.
Médiation : confidentialité et créativité
La médiation offre un espace neutre où les parties peuvent chercher des solutions inventives, loin des rigidités de la procédure classique. Les entreprises apprécient la discrétion et la liberté de parole que ce cadre permet, surtout dans les dossiers complexes ou à forte dimension humaine.
Deux autres procédures complètent ce panorama et méritent d’être connues :
- Procédure participative : ici, chaque partie, avec son avocat, s’engage à négocier activement pour trouver une sortie de crise sans passer immédiatement devant le juge.
- Procédure simplifiée de recouvrement : idéale pour les créances incontestées, elle est pilotée par un commissaire de justice et permet de gérer rapidement et efficacement les impayés.
La variété de ces modes alternatifs offre aux entreprises un véritable levier stratégique. Choisir la bonne méthode, pour sa rapidité, son coût, sa discrétion ou son efficacité relationnelle, devient un enjeu quotidien pour les directions juridiques et les dirigeants.
Sanctions, exceptions et enjeux pratiques pour les acteurs économiques
L’article 750-1 du code de procédure civile ne se contente pas d’afficher une bonne intention. Les conséquences sont concrètes : passer outre la tentative de règlement amiable, c’est courir le risque que le juge écarte purement et simplement la demande. Le dossier s’arrête net, le temps investi se volatilise et la position juridique de l’entreprise s’en trouve fragilisée.
Cependant, le texte ne vise pas tous les contentieux. Certaines matières, comme celles relatives à la sécurité sociale ou au contentieux électoral, échappent à cette obligation. Par ailleurs, des exceptions existent en cas d’urgence manifeste ou de délai manifestement excessif. Le juge évalue alors si, dans le contexte, une tentative amiable pouvait être raisonnablement exigée. Autre cas particulier : lorsque l’homologation d’un accord est sollicitée ou que le ministère public intervient.
Dès la phase qui précède le contentieux, la rigueur s’impose. Les directions juridiques structurées anticipent, conservent la preuve des démarches entreprises et documentent chaque initiative : courriers, e-mails, comptes rendus de réunion, tout devient un atout pour démontrer la réalité de la démarche amiable. Dans ce contexte, le rôle de l’avocat prend toute sa dimension, orientant la stratégie pour éviter les écueils procéduraux et sécuriser la recevabilité de la demande. La jurisprudence, de son côté, affine les contours de cette obligation et trace peu à peu les lignes rouges à ne pas franchir.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, de nouveaux réflexes s’installent. Les acteurs économiques réapprennent à négocier, ou du moins à prouver qu’ils s’y sont véritablement employés. L’air du temps n’est plus à l’affrontement systématique, mais à la démonstration d’ouverture et à la preuve de la bonne foi.
En filigrane, une certitude s’impose : dans le paysage judiciaire, ignorer l’amiable revient à avancer à contre-courant. À chaque entreprise de choisir si elle veut subir la procédure, ou la piloter avec intelligence.